La famille Féron 40 ans à Bir-Jdid
La famille Féron d’origine française a exploité une
ferme à Bir-Jdid, dans la province d’El Jadida, pendant près de quarante ans,
d’abord Marcel Féron de 1927 à 1949 puis son fils Raymond Féron jusqu’en 1965.
A notre demande, sa petite-fille, Madame Yvonne Feron, qui a passé une partie
de son enfance et de sa jeunesse dans cette ferme, a bien voulu nous raconter
cet épisode.
Je m’appelle Yvonne Féron et j’ai 73 ans aujourd’hui.
Mon grand-père Marcel Féron, vétéran et blessé de la Première Guerre mondiale,
est arrivé à Bir-Jdid en 1927. Il était accompagné par ma grand-mère et ses
deux fils de 7 et 1 an. Auparavant, il avait reçu un lot de colonisation
officielle sur un bled makhzen en friche d’une superficie de 275 ha, pour une
durée de 99 ans soit jusqu’en 2026. Mais les circonstances de l’histoire ayant
changé, notre ferme a été reprise par le gouvernement marocain dès 1965. Au
départ, mon père devait remplir un cahier des charges très strict de
défrichement, de mise en culture, de construction de bâtiments, de puits, de
plantation d’arbres et de paiements desmensualités sur 15 ans.
Marcel Feron avait fait de la ferme une exploitation
consacrée principalement aux céréales comme dans sa Picardie natale et,
secondairement, à l’élevage de moutons. Cependant les choses ne sont jamais
simples, les années 1930, qui ont suivi la crise économique mondiale, ont été
particulièrement difficiles financièrement car le blé se vendait très mal. La
famille alors ne put tenir que grâce à un immeuble de rapport qu’elle possédait
avant de venir au Maroc et qu’elle avait gardé à Clermont-Ferrand. A la fin des
années 1940, mon grand-père a pris sa retraite à Casablanca dans une maison
qu’il avait achetée dans le quartier du Maârif. C’est à ce moment-là que mon
père Raymond Féron a repris la gestion de la ferme. Ma mère, Eudoxie, réfugiée
politique espagnole fut expulsée du Portugal vers le Maroc, pour des raisons
politiques, en 1938. Elle obtiendra sa naturalisation française en juin 1942
après son mariage avec mon père.
Mon père et ma mère travaillaient dur comme paysans. En
effet, comme mon père devait payer un loyer à ses parents, les recettes de la
ferme devenaient insuffisantes aussi a-t-il réorienté la production en se
consacrant désormais principalement à l’élevage. Ce changement fut bénéfique :
la ferme rapportait davantage et permettait des revenus plus réguliers pour
pouvoir assurer la paie des ouvriers tous les mercredis soir car on ne
travaillait pas le jeudi puisque le personnel allait au souk hebdomadaire
khémis de Bir-Jdid. Il y produisait des bovins de boucherie alimentés grâce aux
cultures produites sur place. Il achetait des génisses ou des bovillons sur les
souks qui étaient ensuite engraissés à la ferme et revendus à des maquignons de
Casablanca. On produisait aussi des veaux de lait pour le marché central de
Casablanca et des porcs pour la clientèle européenne.
Nous avions sept ouvriers agricoles en permanence qui
logeaient sur la propriété dans des nouallas. Ces ouvriers marocains
disposaient d’un bout de terrain pour y cultiver des légumes, élever des poules
et avoir une vache et son veau qui dans la journée, allaient paître avec le
troupeau et que l’ouvrier ramenait chez lui le soir pour la traire. Le gardien
et sa femme, employée de maison, avaient une pièce en dur et une cuisine
extérieure entourée d’une zériba (enclos) et avaient un âne. Au moment des
récoltes, mon père engageait des saisonniers qui venaient s’installer sur place
avec leurs khaïmas. Afin de rentabiliser son matériel agricole, moissonneuses
batteuses, camion et tracteur, mon père faisait aussi entreprise de battage
pour les fellahs des alentours. Nous nous sommes toujours extrêmement bien
entendus avec le personnel qui a été très stable pendant des décennies.
Certains ouvriers engagés par mon grand-père sont restés avec mon père puis
certains enfants de ceux-ci jusqu’à notre départ.
Comme mon père était arrivé à Bir-Jdid à l’âge de 7
ans, il se sentait Marocain. Quitter la ferme à 45 ans fut pour lui une grande
déchirure car il n’avait jamais imaginé vivre dans un autre pays. Il souffrit
d’une dépression et fut suivi par le docteur René Bouganim, ancien de Mazagan,
qui venait souvent chez nous à Aix-en-Provence dans les années de 1970 jusqu’au
décès de mon père en 1992.
Toute notre famille avait appris l’arabe marocain, mes
grands-parents le parlaient plus ou moins bien, mon père et mon oncle qui
étaient arrivés très jeunes le parlaient parfaitement sans aucun accent. Mon
frère et moi, qui sommes nés au Maroc, nous avons parlé l’arabe avant le
français grâce à nos nounous marocaines.
Aujourd’hui encore nos souvenirs sont ancrés au Maroc,
à Bir-Jdid et à El Jadida. Dans cette dernière ville, ma grand-mère,
Marie-Joséphine, née en 1890 et décédée en 1957, y est enterrée dans le
cimetière chrétien.
Par Mustapha JMAHRI (Ecrivain)
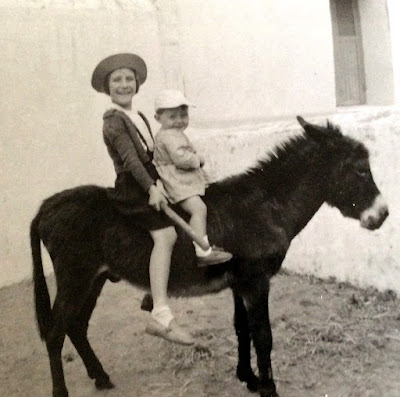


Commentaires